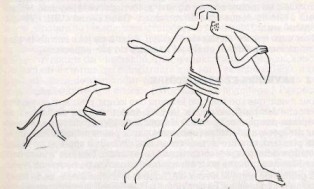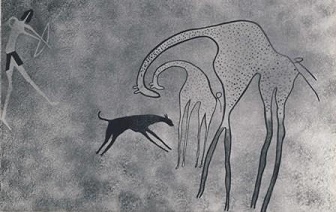ETHNOLOGIE CANINE HISTORIQUE Premières images |
.
Introduction à la découverte d'images néolithiques |
.
datations |
||
![]()
*
L'étude des sépultures a montré qu'on peut dire en gros que les relations Homme /Chien incluant des pratiques telles que décrites, datent au moins du Néolithique ( 2eme "âge de la pierre"), étalé d'environ - 10.000 à - 2.000, en comptant large |
C'est
l'âge de l'émergence et de l'expansion de l'art rupestre
au prix d'un changement si bouleversant que d'aucuns
parlent de "révolution néolithique" et que
personne ne comprend vraiment...
Ce qui fait dire à
F. Behn,
dans "l'art
préhistorique en Europe", Histoire de l'art, éd.
Payot, à propos de l'art
rupestre du Levant espagnol,
| ["...] L'art de cette époque offre le plus violent contraste avec l'art précédent, dans les régions franco-cantabriques où il connaissait un très grand épanouissement.....".F.Behn, op.cit, p17 |
Vocabulaire
Selon H.J. Hugot Le Sahara avant le désert, Ed. des Hespérides, 1974,
| "[..] Est dite « rupestre » toute expression graphique, gravure ou peinture, utilisant comme support une paroi rocheuse, indépendamment de sa qualité et de ses dimensions.[..]" Hugot, p. 238 |
L'art paléolithique des grottes du Périgord et autres n'échappe pas à proprement parler à cette définition.
Bien que les
adjectifs qui qualifient ces "deux arts" soient
synonymes, de même que leur nature, ils se trouvent
ainsi opportunément individualisés dans leur
chronologie et leur particularisme qui fait dire à Hugot
à propos de l'art rupestre :
| "[..] Les auteurs en sont, au cours des millénaires les populations les plus diverses, du début du Néolithique à l'Islam. Tous les groupes culturels que ce livre décrit y ont, plus ou moins suivant les cas, contribué."... Hugot, op.cit.,p 238 |
![]()
On va donc
désormais trouver l'art rupestre partout, généralement
moyennement esthétique, mais, par bonheur pour nous,
figuratif et
narratif,
véritable "Journal" des rochers...
| "[..]
L'être humain qui, à l'époque paléolithique,
était rarement représenté devient le centre d'intérêt et l'animal
est toujours en rapport avec l'homme. [..] les reproductions de l'homme, ou de la bête, sont empreintes du plus grand dynamisme. [..]" F.Behn, p18 |
Difficultés d'Analyse
Dans l'ouvrage cité, J.H.Hugot, ne manque pas de souligner la principale difficulté de son interprétation :
| [...]
"des datations
difficiles Mais, précisément, comment déterminer les auteurs, ou du moins l'âge des figurations rupestres, qui peuvent, sur la même paroi, être séparées par plusieurs millénaires ?. Hugot, p240 |
L'étude par les moyens modernes de recherche est en cours et ses conclusions sont encore loin d'être définitives
![]()
C'est
par des exemples sahariens que commencent toujours,
dans la bibliographie générale canine, les figurations
les plus anciennes de l'espèce ..
C'est donc le point de départ de toute analyse de la
question, ce qui ne signifie pas que le sujet soit
définitivement circonscrit au Sahara.
Or comme le souligne Hugot, op.cit. :
| [..] " il n'y a pas d'imagerie rupestre au Sahara avant le Néolithique." (Hugot) |
Mais il faut donner une date au moins approximative à chacune des images et c'est de la plus grande difficulté
| "[...] Henri Lhote .....a beaucoup contribué à leur classement par étages. Bien entendu, dans les détails, ce classement reflète plus une méthode de travail qu'une réalité absolue, au sens scientifique du terme, mais il a le mérite d'exister et nul ne conteste plus d'ailleurs les grandes divisions relatives qu'il propose....Hugot, p239 |
![]()
| "Les
grandes divisions chronologiques [...] Au fil des
millénaires remplissant les époques du
Néolithique et des premiers âges des métaux,
les grandes divisions, à la fois stylistiques et
chronologiques, sur lesquelles tout le monde est
d'accord, sont les suivantes : |
*
|
On
peut lire une partie des discussions sur le sujet dans l'article
de H. Lhote, G.
Camps et G. Souville, « Art rupestre », in 6 | Antilopes
– Arzuges, Aix-en-Provence, Edisud, («
Volumes », no 6) , 1989, accessible en ligne ![]() http://encyclopedieberbere.revues.org/2599
http://encyclopedieberbere.revues.org/2599
Lhote y écrit en particulier :
| "Cet étage est incontestablement le plus ancien dans l’état actuel de nos connaissances. [..] Malheureusement, aucune datation par le C.14 n’est venue, jusqu’ici, dater les buffles et les grands éléphants, tant dans le Sud oranais qu’ailleurs au Sahara. [..] H. Lhote, 1989 |
Muzzolini
| "1)
récuse la notion de période bubaline...... Pour nous, cette prétendue période bubaline n'est qu'un style, une école d'âge déja bovidien" ou "pastoral"...A. Muzzolini, op.cit. |
Les dates (au moins -5000 pour Lhote) lui paraissent également "très hautes"
D'autre part,
pour étayer leur argument de grande ancienneté de cette
période, les premiers auteurs/chercheurs arguaient du
fait que les gravures ne représentent que des animaux
sauvages et sont donc antérieures à l'époque connue
des domestications (à part celle du chien).
Or Jean
Loïc Le Quellec, sur son site : http://rupestres.perso.neuf.fr , art. : "Chasseurs"
et "Pasteurs" au Sahara : " les "Chasseurs
archaïques" fezzanais chassés du paradigme" , souligne que :
| "...parmi ces gravures, la présence de bovins domestiques est bien attestée par des troupeaux accompagnés de personnages, et surtout par des boeufs porteurs, montés, sellés, décorés, tenus en longe et accompagnés de chiens.... J L Le Quellec, 2009 |
Les
discussions sur ces chronologies étant ce qu'elles sont,
elles réservent des conclusions ultérieures changeantes...
Le classement par dates et périodes est aléatoire sauf
plus ou moins relativement, en tenant compte des styles
et écoles.
|
Donc, nous envisagerons séparément gravures et peintures en les classant par date "plausible" pour chacune, de la plus ancienne à la plus récentes .
![]()
Interprétation des sujets
Difficultés qui nous concerne particulièrement :
![]() diagnose de l'espèce
diagnose de l'espèce
nature
réelle des sujets faisant l'objet des figurations et,
en l'occurence, les chiens...
Donc
chien
ou
pas
chien
?
![]() Dans l'ouvrage
déjà cité sur ce site : "L'art de la Préhistoire"
de L-R. Nougier,
Dans l'ouvrage
déjà cité sur ce site : "L'art de la Préhistoire"
de L-R. Nougier,
"Plus rares sont les scènes où les chasseurs utilisent les services du chien, comme à Alpera.* Certains ont voulu voir, dans la présence de ce fidèle compagnon de l'homme, un indice chronologique, pour une datation tardive de ces fresques. L'argument ne tient pas.[.]" Nougier, p 258 |
* scène de chasse au cerf peinte dans la Cueva Vieja d'Alpera (Espagne), relevé de J. Cabre Aguilo.)
Discussion: la nature "canine" du dit "chien" de ce document se discute:
N.B.: dans les arts anciens du
Moyen Orient, par exemple, on note que la
différence lion/chien la plus constante dans les
représentations est le "pompon"
terminal de la queue du lion....., |
![]() 2e
exemple : scène de chasse à l'auroch constituant la fig5 de l'article de Majeed Khan, Rock art of Saudi
Arabia, 2013,
www. mdpi.com/journal/arts
2e
exemple : scène de chasse à l'auroch constituant la fig5 de l'article de Majeed Khan, Rock art of Saudi
Arabia, 2013,
www. mdpi.com/journal/arts

sélection dans une photo web ![]()
![]() gravures
neolith.2/Arabie
gravures
neolith.2/Arabie
.
| La caractéristique la plus fiable de
reconnaissance du chien,
précisémment utilisable sur le tableau ci-dessus
pour l'animal de droite est la queue
relevée depuis la base et enroulée
|
Un des
grands "handicap" du chien pour être reconnu
sur les anciennes images réside dans son absence
de corne par
rapport à la plupart des autres animaux domestiques (plus
anciennement domestiqués que cheval ou dromadaire).
Dans les cas de schématisme extrême de certaines
périodes on se contentera donc de parler de "cornus"
ci-dessous
: scannée dans l'ouvrage de H. Lhote : "Les chars rupestres
sahariens", éd. des Hespérides,1982, p 168, fig 54, .avec la légende: [..].époque caballine
[..] Abri de Tassigmet, oued Djerat, Tassili,[..]
relevé de J.Lesage, mission H. Lhote 1959,
Ce dernier exemple fournit en plus, l'occasion de s'interroger sur un autre problème compliquant les interprétations d'images qui est celui des superpositions Ici (ci-dessus): la superposition de scènes dessinées à des moments différents est plausible ... et même probable, En efffet : il y a bien des chiens dans
ce tableau Interprétation
: Si
le relevé est fidèle
: le dessin de cette scène n'est pas d'un seul
jet...... Lévriers
de la même "époque des chars"
Le problème des superpositions
reviendra au fil de nos recherches d'images de
chiens, sous des angles divers : |
|||||||
sous le triple rapport: |
fidélité des relevés fidélité des reproductions fidélité des oeuvres au sujet |
Les
premières images qui nous sont parvenues sont, pour la
plupart, des "relevés" qu'ont publié les
pionniers découvreurs des oeuvres....
Elles soulèvent beaucoup d'interrogations.
exemple
concernant notre sujet canin qui permet de s'interroger ![]()
| 1) Copie de ci dessus, art. Muzzolini cité |
2) relevé issu de "Le
chien", Méry, op. cit.
|
3) scan. sur X.
Przezdziecki "Le destin des Lévriers'" op.cit. lég. : Lévrier accompagnant un chasseur masqué
|
de gauche à droite les
deux premiers sont très semblables mais le
troisième est assez différent, *N.B. : léger doute
pourtant à ce sujet : en effet, le guerrier de
droite, nettement plus allant que les deux de
gauche apparaît peut-être dans un autre doc.
mais sans le chien.... , en tout cas sur la
reproduction observée |
||
.
Pour comparaison : sur les
images rupestres ci-dessous nous
pensons que |
||
|
||
|
||
web |
||
Noter
dans tous
les cas de chiens, la proximité et l'interaction
de l'Homme, |
||
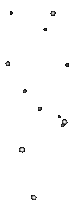
Bien sûr, rien ne vaudra désormais les photos, bien que, sans traitements spéciaux des oeuvres sur le terrain, elles soient pour le moment souvent difficiles à interpréter, en attendant des procédés de plus en plus modernes...
B.Q. 2013
révision 2021
![]()